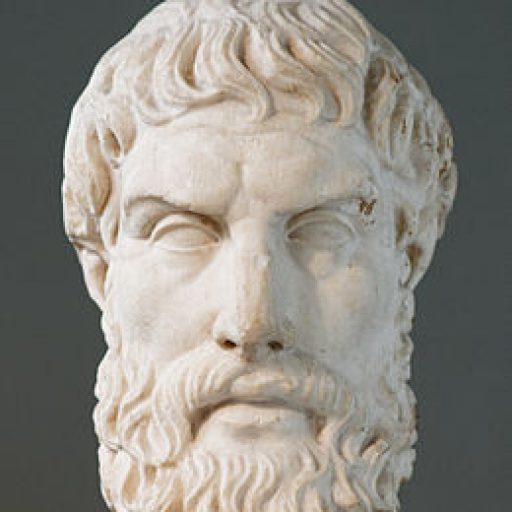Depuis longtemps je voulais discuter certaines des thèses de Chantal Mouffe. Plutôt que de reprendre en bloc ses interventions, je préfère pour l’instant proposer une lecture de son ouvrage L’illusion du consensus qui, adressé à la science politique libérale, compte dans sa volonté de réhabiliter le caractère conflictuel de la politique en général et de l’approche libérale en particulier. Cette question semble, malgré le temps écoulé depuis ce texte, toujours d’actualité, quand les tenants d’une gouvernabilité rationalisée semblent toujours vouloir faire l’impasse sur les humeurs du peuple, mais que d’autres soufflent sur les braises de la contestation, à l’instar du Rassemblement National. Plusieurs éléments me semblent cruciaux dans son analyse : la réhabilitation du conflit et des affects en politique, la nécessité de redonner à voir un clivage droite/gauche au lieu de la glorification d’un (extrême?)centre, mais aussi la nécessité de discuter pied à pied le rapport à Carl Schmitt – et de manière secondaire à certains auteurs post-modernes un peu anecdotiquement évoqués dans son livre.

Chantal Mouffe, dans L’illusion du consensus 2016(On the Political, 2005), critique la croyance libérale en un consensus rationnel universel, qu’elle juge dangereuse pour la démocratie. Elle se fonde notamment sur les travaux de Carl Schmitt, qui avait proposé dans La notion de politique, une approche polémique de la politique, au sens propre du terme, puisqu’il en faisait l’activité polémique, conflictuelle, avec pour paradigme la guerre et sa polarisation entre deux instances antagoniques engagées dans un combat absolu. Elle distingue cependant l’antagonisme de Carl Schmitt, basé sur la dichotomie ami/ennemi, de son propre concept d’agonisme, qui reconnaît la légitimité des adversaires dans un cadre démocratique. L’intérêt de son approche tient à ce que la politique démocratique doit mobiliser les passions et les désirs des citoyens, et non se limiter à des compromis entre intérêts et valeurs, impossibles. Elle remet donc en cause le postulat libéral – dans ses variantes – selon laquelle la politique permettrait d’aboutir à un consensus par un arbitrage rationnel. Cette approche consensuelle de la politique, prégnante chez les élites libérales, les conduit à négliger l’importance d’un conflit, à vouloir neutraliser les affects en politique, et finalement conduit à un résultat inverse de celui proclamé : le conflit n’est pas nié, mais déplacé sur le plan d’une condamnation morale sûre d’elle même, tandis que les partis d’extrême droite capitalisent les déceptions liées à la recherche d’accords entre les partis de gouvernements. Si le contour des distinction droite – gauche s’estompe, les conflits sociaux qu’ils recouvraient n’ont pas disparu. L’enjeu démocratique n’est donc pas de nier la conflictualité, de croire que des gouvernements techniques permettent de gérer un pays, mais de trouver les formes par lesquelles il s’agit de la rendre visible et non de la nier en démocratie. Si ce texte commence – un peu – à dater, il se montre prémonitoire dans bien des analyses. Le mouvement de gilets jaunes, l’élection de Milei, Trump, et la force de l’extrême droite en France et en Italie aujourd’hui l’attestent douloureusement. Le rapport critique à Schmitt ne doit cependant pas nous égarer, la prégnance du conflit, le risque de la neutralisation du politique par l’idéal rationnel individualiste sont des faits incontournables désormais, que l’on ne peut écarter. Si une partie de cet ouvrage reprend un article plus ancien encore qu’elle avait fait paraître « Penser la démocratie moderne avec et contre Carl Schmitt », il y a un enjeu à penser ces faits sans Carl Schmitt, car la dialectique antagoniste de la politique n’a pas besoin de se référer à lui, non seulement parce qu’il a épousé la cause Nazie dans les années trente, mais parce que ses textes des années 20 où il défendait cette thèse la mobilisait déjà au profit d’une approche mortifère de la politique. On peut penser avec Mouffe la pertinence d’une vivification de la démocratie par la reconnaissance de la part irréductible de conflit, sans recourir à Schmitt – ni d’ailleurs à certains auteurs post-modernes, comme Heidegger ou Derrida.
Notons également l’ambiguïté, sur laquelle les partisans de la démocratie libérale peuvent faire fond, de la critique de l’universalisme rationnel et de l’individualisme. S’il s’agit de montrer comment, dans une approche qu’on pourrait qualifier de marxiste, le capitalisme libéral transfère au politique les caractères de l’homo œconomicus à un homo politicusindividué et rationnel, c’est compréhensible. Mais des formules qui rejetteraient sans autre précaution une approche rationnelle de la politique et une exigence d’universalisme comme refus d’assignation de quiconque à une essence, fut-elle culturelle, seraient dramatique. Ce n’est pas, semble-t-il le propos précis de cet ouvrage, mais c’est parfois comme tel qu’il est reçu, par ceux qui l’approuvent comme par ceux qui le contestent, comme la philosophe Susan Neiman, dans son livre La gauche n’est pas woke dont la critique ici feint de croire que l’adversité – et non l’animosité – prônée par Chantal Mouffe ne serait qu’une forme de gestion de l’état de nature hobbesien. Ainsi dans The return of the Political cette dernière affirme en présentant la logique de son travail : « Je soutiens que, pour radicaliser l’idée de pluralisme et en faire le vecteur d’approfondissement de la révolution démocratique, il faut rompre avec le rationalisme, l’individualisme et l’universalisme. »1 Si la critique du rationalisme ne vise que les tenants de l’agent rationnel et qui négligent la relation passionnelle de la politique, alors elle est acceptable. Cette critique des présupposés méthodologiques de l’individualisme de l’économie néoclassique a été faite maintes fois. Et n’oublions pas qu’un Spinoza entend construire une approche rationnelle des passions et les accueillir dans son système sans les mépriser : réintégrer les passions dans l’analyse des processus politiques sociaux et économiques, ne signifie pas renoncer à la raison bien au contraire. N’est-ce pas ce que Frédéric Lordon entreprend depuis des années en ébauchant une économie des affects ? Si la critique de l’individualisme vise à la fois la conception abstraite de l’individualisme méthodologique qui postule des agents rationnels comme donnés, là où les sciences humaines nous permettent de concevoir un individu résultant d’un processus culturel et historique, ou encore celle de l’individualisme qualifié de possessif par Mc Pherson, cela rejoint une conception marxiste tout-à-fait pertinente. Si par universalisme on entend en fait l’utilisation idéologique par les grandes puissances occidentales lors de la colonisation, puis par les intellectuels patentés du néo-libéralisme américain – pour faire vite – là encore pas de difficulté majeure. D’ailleurs les dernières pages de l’ouvrage, qui mettent en scène un questionnement concernant le multiculturalisme illustrent parfaitement les enjeux du débat.
Le politique et la politique
Le premier chapitre de l’ouvrage reprend une distinction longuement discutée dans les débats des politistes de l’après guerre, la distinction entre le politique et la politique. La politique est un phénomène, un fait réel qu’il faut analyser comme tel, il se produit dans l’histoire. Toute la difficulté tient à ne pas figer les déterminations du terme dans l’une quelconque de ses figures, comme la Cité ou l’État, c’est-à-dire de définir le concept universel de politique par delà l’histoire. Julien Freund, dans L’essence du politique, a tenté une telle définition, notamment en distinguant les deux sens du substantif : la politique serait une action, un mouvement qui dépasse l’instance dans laquelle elle s’incarne, le politique. Pourtant, cette instance, nécessairement historique, ne constitue à son tour qu’une figure du politique, que Freund entend saisir comme essence permanente2. A ce titre, Freund entend non seulement distinguer le politique d’autres notions, certaines constituant de essences pures comme l’art ou la science, d’autres des notions dialectiques, comme le droit, constitué de morale et de politique, mais aussi penser le politique comme le fruit d’une caractéristique anthropologique. Il y a donc pour lui un statut ontologique au politique : car l’homme « est un être social, vit dans une collectivité qui constitue pour une grande part la raison de son destin. »3 On peut alors caractériser à grands traits le politique comme le lieu de conflits : « relations du commandement et de l’obéissance, du privé et du public, de l’ami et de l’ennemi, et finalement le but et le moyen spécifique du politique. »4. Cette distinction nous permet donc effectivement de rendre compte de ce qu’il y a de spécifiquement politique. Toutefois, elle dénote d’un certain rejet de l’activité politique au profit de l’instance censée en garantir l’exercice qui se confond souvent avec le lieu du pouvoir. Pierre Vidal Naquet, dans son introduction à Moses I Finley, démocratie antique et démocratie moderne, propose l’interprétation suivante : « Mais précisément, pour Julien Freund, il convient de distinguer le politique qui est une essence et la politique qui est une activité envahissante et à la limite destructrice du politique. »5 Il y va d’une interprétation de forme platonicienne parce que portant sur les essences qui s’interdit de penser la politique comme interprétation permanente de l’ordre établi. Or cette dimension est impliquée dans la politique elle-même, si l’on veut bien considérer que son objet propre est bien la détermination d’un monde commun.
Mouffe pour sa part distingue « le politique », la dimension d’antagonisme constitutive des sociétés humaines, de « la politique », les pratiques et institutions organisant la coexistence humaine dans un contexte de conflictualité. Elle rejette alors l’approche rationaliste dominante en théorie de la démocratie, qui empêche de poser les questions cruciales liées à la politique démocratique. Cette approche dominante dans la science politique d’inspiration libarale, incapable de reconnaître les identités collectives et le pluralisme social, fait l’impasse sur le politique dans sa dimension antagonistique. Mouffe avertit alors que « le fait de concevoir le but d’une politique démocratique en termes de consensus et de réconciliation n’est pas seulement erroné conceptuellement mais dangereux politiquement. »
Elle s’appuie pour cela sur Carl Schmitt pour souligner que le libéralisme, par principe, nie le politique. Schmitt affirme en effet que la pensée libérale élude l’État et la politique, se mouvant confusément entre morale et économie. Elle en retient Schmitt la nécessité de reconnaître la dimension antagonistique du politique, tout en critiquant au passage son exigence d’un demos homogène, contraire au pluralisme. Et l’on sait que l’adhésion de Schmitt au thèses qui incarnent le politique dans un peuple, un État et un führer n’ont pas été des vains mots. Rallié à la cause nazie, il tient en 1934 une conférence, dont le titre même est éloquent, « la science du droit contre l’esprit Juif », qu’il conclut en citant Hitler : « en luttant contre le juif, je lutte pour l’œuvre du Seigneur. »
Parce que pour elle « la croyance en la possibilité d’un consensus rationnel universel a conduit la pensée de la démocratie sur une fausse route », elle invite à penser le concept d’agonisme, où les adversaires reconnaissent la légitimité de leurs opposants, contrairement à l’antagonisme où l’ennemi doit être éradiqué. La prise en compte de l’agonisme c’est celle de la part irréductible de conflictualité dans l’existence, et singulièrement en politique. L’agonisme permettrait ainsi une confrontation démocratique régulée, évitant l’auto-destruction du pluralisme parlementaire. Reprenant les thèses de Schmitt des années 1920, elle entend par là le fait paradoxal qu’à force de vouloir nier les oppositions par la recherche d’un consensus, le parlementarisme perd la confiance du peuple qui exprime ses passions par d’autres voies, ou finit par une forme de gouvernement technique qui par ailleurs se découvre de nouveaux ennemis disqualifiés moralement, parce que prétendus – ou réellement – populistes d’extrême droite ou terroristes. Mouffe insiste bien sur la dimension non-rationnelle de la politique, mobilisant les passions et les affects, et critique les théories libérales qui négligent cette dimension. Elle précise que « l’agonisme est une relation nous/eux où les parties en conflit, bien qu’elles admettent qu’il n’existe pas de solution rationnelle à leur désaccord, reconnaissent néanmoins la légitimité de leurs opposants. Ce sont des «adversaires » et non pas des ennemis. »
Si elle rejette ce qui en Schmitt affirme l’existence nécessaire d’un demos homogène, allant pour lui jusqu’à l’antisémitisme, elle reconnaît en revanche sa contribution à la compréhension des identités politiques relationnelles. Elle s’appuie ici sur des penseurs post-modernes comme Derrida, Laclau et Heidegger pour montrer que tout ordre est politique et fondé sur une forme d’exclusion. Les pratiques hégémoniques établissent un ordre temporaire, toujours susceptible d’être remis en cause par des pratiques contre-hégémoniques. Ainsi elle conclut que « tout ordre est politique et est fondé sur une certaine forme d’exclusion. »
En 2005 à l’encontre de la troisième voie centriste, incarnée par exemple par Tony Blair, la sociale démocratie italienne ou dans une moindre mesure François Hollande, elle soutient que la confrontation droite/gauche est essentielle pour mobiliser les passions politiques et éviter que les antagonismes ne prennent des formes essentialistes ou morales non négociables, et par là plus dangereuses encore. Elle critique l’irruption des thèses de politistes sur une prétendue post-démocratie, qui en apparence semble vouloir se débarrasser de l’ennuyeux problème du peuple ingouvernable, réduisant la politique à des dispositifs étatiques et des compositions entre intérêts sociaux. Face à cet oubli du peuple et de ses motivations, elle affirme que « une politique démocratique ne peut pas se limiter à établir des compromis entre les intérêts et les valeurs ou à engager une délibération sur le bien commun ; elle doit aussi s’intéresser aux désirs et aux rêves des gens. » Par là elle rejette la perspective post-politique, qui prétend que les sociétés modernes ont évolué au-delà des identités collectives et des conflits adversariaux traditionnels. Cette perspective, défendue par des sociologues comme Ulrich Beck et Anthony Giddens, nie en effet la dimension antagonistique du politique et conduit à une résignation face à l’hégémonie existante.
Son analyse du succès des partis populistes de droite, qu’elle attribue à l’absence d’un vrai débat démocratique dans les sociétés post-démocratiques montre les effets de la moralisation de la politique, où les antagonismes sont formulés en termes de bien et de mal, et non en termes politiques. Cette moralisation défensive revitalise paradoxalement le modèle antagonistique de la politique, contrairement aux prétentions ceux qui voudraient opposer une prétendu approche raisonnable et gouvernementale aux revendications de l’extrême droite. Sur le plan internationale elle critique également l’usage des catégories morales par les néo-conservateurs, qu’elle distingue de la pensée de Schmitt. Elle met en garde contre l’illusion d’une démocratie cosmopolitique, soulignant que l’imposition d’un modèle unique, même démocratique, est vouée à susciter des résistances et à faire naître de dangereux antagonismes. Mouffe affirme que « le succès des partis populistes de droite est la conséquence directe de l’absence d’un vrai débat démocratique dans nos sociétés postdémocratiques. »
Sur le plan international, le libéralisme a, selon elle, développé plusieurs approches. Les partisans du cosmopolitisme néolibéral, souvent associés aux États-Unis, voient la mondialisation comme un phénomène bénéfique qui unifierait la planète sous les vertus du capitalisme. Ils croient que la mondialisation, sous le leadership des États-Unis et avec l’aide d’institutions internationales comme le FMI et l’OMC, peut créer un ordre mondial juste. Chantal Mouffe réfute cette approche et son biais idéologique évident ainsi que la subordination du politique au domaine économique. Elle rejette l’idée que la mondialisation économique puisse à elle seule créer un ordre mondial juste. « Vaut-il vraiment la peine de s’étendre sur cette célébration, dépourvue de tout sens critique, de l’hégémonie néolibérale ? Son biais idéologique est si évident qu’il ne laisse aucune place à la politique. Tout est subordonné au domaine économique et à la souveraineté du marché. »
Des partisans du cosmopolitisme démocratique, comme David Held et Daniele Archibugi, mettent l’accent sur l’extension des principes démocratiques au-delà des États-nations. Ils proposent la création de nouvelles institutions globales pour gérer des questions telles que l’environnement, les flux migratoires et l’usage des ressources naturelles. Pour elle cette approche est irréaliste, car l’énorme disparité de pouvoir parmi les membres de l’Organisation des Nations unies rend impossible la réforme de cette institution pour la rendre à la fois plus forte et plus démocratique. Les défenseurs du cosmopolitisme voient la gouvernance mondiale comme une négociation entre une multiplicité d’associations et de groupes d’intérêts ayant une expertise spécifique. Ils conçoivent la politique comme une activité de résolution de problèmes techniques, plutôt que comme un engagement actif de citoyens exerçant leurs droits démocratiques. Là encore elle rejette ces desseins, porteurs d’un caractère post-politique, soulignant que les décisions prises par des organisations internationales sont toujours désavantageuses pour certains et comportent des coûts inégalement répartis.
Les penseurs de la gauche radicale ne sont pas mieux lotis. Michael Hardt et Antonio Negri, dans leur ouvrage Empire, présentent en effet une vision d’un monde unifié par le capitalisme mondial, où la multitude, un contre-Empire en gestation, finira par renverser la souveraineté de l’Empire. Elle y voit un manque de stratégie politique, soulignant que l’idée de la multitude comme sujet révolutionnaire reste une approche abstraite qui ne laisse aucune place à une intervention politique effective dans le cadre des rapports de force effectifs, et des moyens des puissances gouvernementales.
Ainsi elle estime que la croyance en la fin d’une forme adversariale de la politique et dans le dépassement de la division droite/gauche crée un terrain propice à la montée des mouvements populistes de droite. Elle plaide pour une dimension agonistique de la politique, revitalisant la distinction droite/gauche, tout en appelant à une approche pluraliste qui reconnaît la légitimité de certaines revendications et en exclut d’autres.
Elle renvoie dos à dos les approches universalistes et multiculturalistes, soulignant que le modèle occidental de la modernité n’est pas le seul moyen valable de se rapporter au monde et aux autres. Elle propose au contraire une approche pluraliste des droits de l’homme, reconnaissant par exemple l’existence de réponses culturellement spécifiques à la question de la dignité de la personne.
Pour revivifier la démocratie, tout en lui conservant son caractère agonistique, il faut discriminer parmi les revendications celles qui peuvent être acceptées dans le débat démocratique et celles qui doivent en être exclues. Elle critique les théories libérales qui prétendent fonder cette discrimination sur la rationalité et la morale, affirmant que le tracé de la frontière entre le légitime et l’illégitime représente toujours une décision politique, ouverte à la contestation : « depuis Kant, on présente souvent la morale comme un champ d’impératifs universels ne faisant place à aucun «désaccord rationnel ». Cela est pour moi incompatible avec la reconnaissance du caractère profondément pluraliste du monde et de l’irréductibilité des conflits de valeurs. »
1« I argue that, in order to radicalize the idea of pluralism, so as to make it a vehicle for a deepening of the democratic revolution, we have to break with rationalism, individualism and universalism. » p. 7 The rerturn of the political 1993
2 Cf. Notamment son Avant propos de 1965 à L’essence du politique
3 Avant propos de 1965 à L’essence du politique, p. 5
4 id.
5 in Moses I FINLEY, Démocratie antique et démocratie moderne, Payot, p. 9